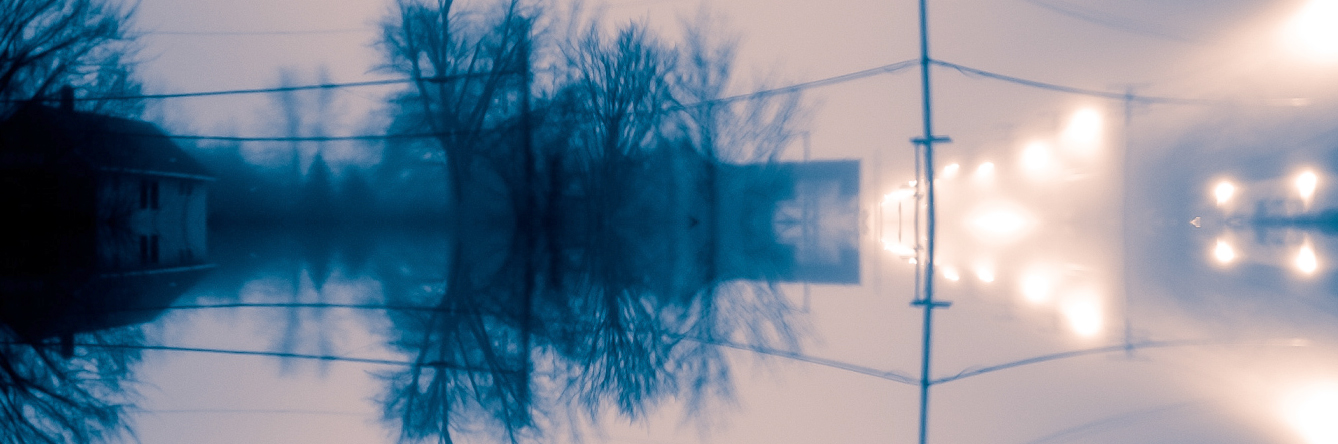Journée d'études Atlas et fiction
Université de Poitiers, 24-25 septembre 2025
Par Charlotte KRAUSS le 11 septembre 2025

Atlas et fiction
Journée d’études
Université de Poitiers, FoReLLIS (UR 15076) – Espace Mendès France
Org. Charlotte Krauss (charlotte.krauss@univ-poitiers.fr)
|
Soirée grand public Mercredi 24 septembre, 18-20h Espace Mendès France 1 Pl. de la Cathédrale, 86000 Poitiers Atlas : entre mondes connus et terres inventées
18h-19h45 Soirée grand public autour des atlas, des cartes et de la fiction Jean-Marc Besse : L’atlas : espace graphique et pratiques cognitives Charlotte Krauss : D’Utopia à Westeros : atlas de mondes imaginaires
Merci de vous inscrire ici (obligatoire, mais gratuit) : www.billetweb.fr/multi_event.php?multi=4357&color=217191&event_id=1291456
|
Jeudi 25 septembre
Journée d’études « Atlas et fiction »
MSHS de Poitiers, salle Mélusine
5 Rue Théodore Lefebvre, 86000 Poitiers
|
9h30 Accueil (café) |
9h45 ouverture
10h-10h45 – Mandana Covindassamy (ENS de Paris)
« Je n’ai rien inventé. Mais j’ai tout trouvé ». De la fiction dans l’Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky
10h45-11h30 – Jessy Neau (Univ. de Poitiers, FoReLLIS)
Se promener dans le Londres de Charles Dickens ou le Devon d’Agatha Christie : atlas et guides touristiques de l’Angleterre des écrivains
11h30-12h15 – Urs Urban (Bauhaus-Universität Weimar)
L’Atlas sentimental de la España vacía (2021) de Sergio del Molino : Topographies du vide dans l’imaginaire littéraire.
|
Pause (midi) |
13h45-14h30 – Pierre Martin (Univ. de Poitiers, FoReLLIS)
L’imaginaire au seuil de l’Atlas (Renaissance et siècle classique)
14h30-15h15 – Myriam Marrache-Gouraud (Univ. de Poitiers, FoReLLIS / IUF)
Personnages et fiction réaliste dans les premiers atlas du XVIe siècle
|
Pause (café) |
15h45-16h30 – Éric Puisais (UCO Niort)
La Carte de Tupaïa
16h30-17h15 – Sophie Aymes (Univ. de Poitiers, FoReLLIS)
Jacquetta Hawkes : de la fiction géologique à l’atlas
Résumé de la journée
Depuis l’apparition de Google Maps et d’autres applications GPS dans les années 2000, on aurait pu croire que le genre de l’atlas n’avait plus de raison d’être, l’information sur presque tous les lieux de la planète étant désormais disponible en quelques clics. Pourtant, l’atlas connaît aujourd’hui un regain d’intérêt : de nombreux éditeurs publient des atlas consacrés aux lieux les plus curieux, ou même à des entités détachées de la géographie, souvent sous la forme de beaux volumes destinés aux amateurs de cartes, aux armchair-travellers et aux bibliophiles.
Progressivement, l’atlas semble quitter le rayon « géographie » des librairies pour rejoindre celui de la « littérature ». L’exemple le plus célèbre de ce glissement est sans doute celui de l’écrivaine et artiste allemande Judith Schalansky avec son Atlas des îles abandonnées (2009), sous-titré dans sa version originale : Cinquante îles que je n’ai jamais visitées et que je ne visiterai certainement jamais. Ici, le but n’est plus tant l’information que le plaisir esthétique et narratif : belles cartes, anecdotes singulières, fragments d’histoires… de fiction, peut-être ? Dans son sillage, de nombreux ouvrages ont vu le jour : L’Atlas des contrées rêvées, L’Atlas des lieux maudits, L’Atlas des pays qui n’existent pas, etc. D’autres encore recensent les lieux littéraires ou les cartes présentes dans les arts, de L’Île au trésor de Stevenson au générique de Game of Thrones, comme The Writer’s Map de Huw Lewis-Jones ou L’Atlas des lieux littéraires de Cris F. Oliver.
Ce rapprochement entre atlas et fiction n’est pourtant pas nouveau. Depuis la naissance du genre, à la fin du XVIᵉ siècle, l’imaginaire a toujours été présent : on inventait des contrées encore inexplorées, on peuplait les marges des cartes d’êtres mythiques ou d’animaux fabuleux, comblant ainsi le vide des océans ou des zones blanches. Les monstres marins figurant sur la carte marine d’Olaus Magnus (XVIᵉ siècle) en sont l’exemple le plus fameux.
L’objectif de cette journée d’études est d’interroger ces liens entre atlas et fiction. Si une attention particulière sera portée aux productions contemporaines, l’histoire du genre et les périodes anciennes seront également considérées, dans une perspective interdisciplinaire : lettres, géographie, philosophie, histoire. Les réflexions porteront aussi bien sur la matérialité du livre que sur la relation texte-image. Alors que les cartes et la cartographie ont suscité de nombreux travaux récents, l’atlas en tant que forme spécifique a été moins étudié. Pourtant, par l’esthétique commune qu’il impose aux cartes qu’il rassemble, l’atlas suggère une cohérence et construit un monde à la frontière de la réalité et de la fiction.
Cette journée, à la croisée des études de genre littéraire, de l’intermédialité et des théories de la fiction, donnera lieu à une publication dans les Cahiers FoReLLIS. Organisée par le FoReLLIS (UR15076) en partenariat avec l’Espace Mendès France (Poitiers), dans le cadre d’un programme consacré à la cartographie, elle sera précédée d’une conférence ouverte au grand public la veille au soir.
Résumés des communications
& notices biobibliographiques
☞ Sophie Aymes
Jacquetta Hawkes : de la fiction géologique à l’atlas
Jacquetta Hawkes (1910-1996) est une archéologue et écrivaine anglaise qui reste aujourd’hui surtout connue pour son ouvrage A Land (1951). Ce texte scientifique et poétique offre une plongée dans le lointain passé de la formation géologique de l’archipel britannique et irlandais et retrace les mouvements migratoires qui l’ont peuplé. L’autrice livre un récit travaillé par l’imaginaire moderniste de la gestation des formes, illustré de dessins d’Henry Moore et de Ben Nicholson, ainsi que de photographies de Walter Bird. A Land narrativise l'histoire géologique des îles britanniques en tant que fiction, au sens étymologique du terme, un « façonnage » que prolonge l’activité poïétique humaine. Très impliquée dans la vulgarisation scientifique de l’archéologie, Jacquetta Hawkes contribua par la suite à des publications telles que History of Mankind (1963) pour l’UNESCO. Elle en vint à changer progressivement de format et fit paraître deux atlas dans les années 1970 (The Atlas of Ancient Archaeology de 1974 et The Atlas of Early Man de 1976). Ma communication retracera l’évolution intellectuelle de Jacquetta Hawkes, depuis le récit téléologique d’inspiration darwinienne de A Land à l’interprétation « diffusionniste » de l’histoire humaine proposée dans ses atlas. Pourquoi avoir choisi ce format ? Que devient sa « fiction géologique » à l’époque où la conquête spatiale impose de nouvelles formes de visualisation de la Terre ?
|
Sophie Aymes est professeure de littérature britannique à l’Université de Poitiers. Ses recherches portent sur l’intermédialité, le livre moderniste et l’illustration en Grande-Bretagne. Elle est co-fondatrice du réseau Illustr4tio spécialisé dans les études sur l’illustration, Secrétaire de l’association IAWIS et directrice de l’Equipe B de l’unité de recherche FoReLLIS. Sa monographie Modernist Mediascapes: Illustration, Print Culture, and the Matter of Books paraîtra prochainement chez Legenda. |
☞ Jean-Marc Besse
L’atlas : espace graphique et pratiques cognitives
Il s’agira, dans cet exposé, d’analyser l’atlas comme forme éditoriale et comme dispositif cognitif, à partir de quelques exemples d’atlas modernes et contemporains.
|
Jean-Marc Besse, philosophe et historien, est directeur de recherche émérite au CNRS et directeur d’études à l’EHESS. Ses recherches portent d’une part sur l’histoire des représentations et des pratiques de l’espace et la théorie du paysage, et d’autre part sur l’épistémologie des savoirs géographiques, à l’époque moderne et contemporaine. Il est co-directeur de la revue Les Carnets du paysage (Actes Sud-ENSP). Il dirige la collection « La nécessité du paysage » aux éditions Parenthèses (Marseille). Parmi ses livres : Les Grandeurs de la Terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance (2003) ; Face au monde. Atlas, jardins, géoramas (2003) ; Le goût du monde. Exercices de paysage (2009) ; Habiter. Un monde à mon image (2013) ; La nécessité du paysage (2018) ; Forme du savoir, forme de pouvoir. Les atlas géographiques à l’époque moderne et contemporaine (2022) ; Quelle est la raison des cartes ? (2023). |
☞ Mandana Covindassamy
« Je n’ai rien inventé. Mais j’ai tout trouvé. »
De la fiction dans l’Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky
L’Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky inaugure la collection des atlas poétiques publiée chez Arthaud. Mais en quoi réside la dimension poétique de cet ouvrage qui se consacre à des îles existantes et revendique n’avoir rien inventé ? La fiction peut-elle se loger ailleurs que dans l’écart par rapport à l’existant ? Il s’agira de voir quelle part revient à l’imagination dans le projet qui sous-tend cet atlas et comment la proposition de Schalansky remet en jeu la question de la mimesis dans le theatrum mundi de l’atlas.
|
Mandana Covindassamy est maîtresse de conférences en littérature de langue allemande à l’École normale supérieure - PSL (Ulm) et membre de l’UMR 8547 Pays Germaniques (CNRS/ENS-PSL). Ses recherches portent notamment sur les relations entre cartographie et littérature dans les œuvres de Goethe, W.G. Sebald, Alexander Kluge ou Judith Schalansky. Ses travaux portent également sur la mimesis, sur l’œuvre de Robert Walser ainsi que sur les relations entre la poésie persane et la littérature allemande. |
☞ Charlotte Krauss
D’Utopia à Westeros : atlas de mondes imaginaires
Les cartes de pays imaginaires existent depuis l’Antiquité, et certaines sont devenues emblématiques, comme celle d’Utopia ou, plus récemment, la carte de Westeros (Game of Thrones). Aujourd’hui, des atlas entiers sont consacrés à ces espaces : ils construisent des mondes composés, leur donnent une cohérence graphique et proposent de repenser la fiction par la cartographie.
|
Charlotte Krauss est professeure de littérature comparée à l’Université de Poitiers et directrice de l’unité de recherches FoReLLIS. Son projet en cours consacré aux atlas poétiques s’appuie sur deux de ses centres d’intérêt, les liens entre fiction et politique et les relations entre texte et image. Elle est l’auteur de La Russie et les Russes dans la fiction française du XIXe siècle. D’une image de l’autre à un univers imaginaire (2007) et de La Mise en scène de la nation. Les spectacles dans un fauteuil dans l’Europe post-napoléonienne (2022). |
☞ Myriam Marrache-Gouraud
Personnages et fiction réaliste dans les premiers atlas du XVIe siècle
L’idée de nommer « Atlas » les premiers livres de cartes nous rappelle que c’est par le nom d’un personnage que l’ouvrage qui porte le monde entier se distingue, par exemple, du planisphère ou du globe. Au moment de sa naissance au XVIe siècle, l’atlas inventorie toutes les terres et les mers du monde connu, mais aussi les êtres vivants. Cette enquête propose d’interroger la place réservée aux personnages dans de telles productions graphiques et discursives. Vérité ou fiction ? La présence de personnages dans les atlas, loin d’être strictement décorative ou fabuleuse, mérite d’être interrogée dans le texte comme sur l’image pour sa valeur vraisemblable. Insérer des personnages est un procédé qui construit sans doute une fiction réaliste à la portée de tous, mais ses enjeux sont peut-être plus politiques qu’anecdotiques pour le lectorat européen.
|
Myriam Marrache-Gouraud est professeure de littérature du XVIe siècle à l’Université de Poitiers. Elle est membre du laboratoire FoReLLIS (UR 15076) et membre senior de l’Institut Universitaire de France (IUF). Ses travaux portent sur Rabelais, l’écriture des savoirs et des mirabilia à la Renaissance. Attentive à la rencontre entre l’humanisme philologique et les énigmes du monde, elle s’intéresse à l’éloquence des objets singuliers et au rapport entre textes et images. Ses deux dernières monographies portent sur la poétique du catalogue (La légende des objets, Genève, Droz, 2020 ; L’homme-objet, Genève, Droz, 2022) et proposent de comprendre les musées à partir des textes qui en sont issus. À la croisée de la littérature, de l’histoire du livre et des sciences, son travail étudie les écrits de la curiosité, afin de comprendre leur rôle dans l’histoire épistémique des collections, et dans l’affirmation de ceux qu’on appelait curieux. |
☞ Pierre Martin
L’imaginaire au seuil de l’Atlas (Renaissance et siècle classique)
Le péritexte des Atlas de la période considérée est le lieu privilégié de l’expression, parfois directe, parfois oblique, d’un imaginaire collectif de l’entreprise géographique. On s’intéressera plus particulièrement à la façon dont les frontispices, ces configurations d’allégories empruntées à la Fable et autres motifs iconiques qui se font signes à déchiffrer, s’adressent aux « advisans » (équivalent Renaissance des modernes regardeurs) et acheteurs potentiels.
|
Pierre Martin, professeur retraité de l’Université de Poitiers, a consacré aux images de nombreux articles, dont « Des tatous et des hommes », dans H. Scepi et L. Louvel (éd.), Texte/image – Nouveaux problèmes, P.U. Rennes, colloque de Cerisy, 2005 ; « Un enfant dans le dos. Portrait de l’autre en abominable », dans S. Requemora-Gros et L. Guyon (dir.), Image et voyage, P.U. Provence, 2012 ; « Emblématique, bricolage et conscience sémiotique », revue Textimage, 2016 ; « Le squelette, la pelote et le mouchoir brodé : la collection de singularités anatomiques du Dr Ruysch, objet de méditation », dans F. Fix et L. Le Diagon-Jacquin (dir.), Le Paon d’Héra – Mythologies du fil, 2024). Il a publié aussi trois éditions critiques : les Linguae vitia et remedia (1652) d’Antoine de Bourgogne sous le titre Les vices de la langue et leurs remèdes, Atlande, 2009 ; les Emblemes nouveaux (Francfort, 1617) d’Andreas Friedrich aux P. U. François-Rabelais, Tours, 2013 ; et chez le même éditeur, en 2020, sous le titre Un Monde de Curiosités, le manuscrit aquarellé d’Histoire naturelle d’Elie Richard (1700). |
☞ Jessy Neau
Se promener dans le Londres de Charles Dickens ou le Devon d’Agatha Christie : atlas et guides touristiques de l’Angleterre des écrivains
Le tourisme littéraire est un phénomène majeur au Royaume-Uni, caractérisé par des événements comme le festival Jane Austen, des visites de maisons-musées (Charles Dickens, Arthur Conan Doyle) et des pratiques interactives (reconstitutions de bals, murder parties, jeux de piste). Ces activités puisent dans un imaginaire intertextuel et mondialisé, rendant les lieux fictifs (Pemberley, 21B Baker Street) universels. Des ouvrages tels que A Dickens Atlas ou Agatha Christie's England valorisent le patrimoine cartographique et ré-enracinent ces imaginaires. Les itinéraires proposés, mélangeant lieux fictifs, biographiques et de tournage, renforcent les protocoles intertextuels et transfictionnels du tourisme littéraire, estompant les frontières entre fiction, adaptations et passé idéalisé. L'objectif de cette communication est de distinguer ces configurations au sein des pratiques de tourisme littéraire et fanique. Elle cherchera également à déterminer si ces objets sont une incarnation intermédiale des systèmes de représentations liés à la dichotomie structurelle de l'imaginaire britannique, explorée dans The Country and the City de Raymond Williams, essai fondateur des études culturelles.
|
Jessy Neau est maîtresse de conférences à l’Université de Poitiers et membre de l’unité de recherche FoReLLIS. Ses travaux de recherche se concentrent principalement sur les relations entre la littérature et les écrans, notamment le cinéma et les séries télévisées. Elle a publié Le cinéma de Wojciech Has au miroir de la littérature (2023) ainsi que Littérature et écrans : expansions de l’adaptation (2024) chez Peter Lang. |
☞ Éric Puisais
La Carte de Tupaïa
Considéré comme l’un des plus anciens artéfacts polynésiens conservés par les Européens, la carte de Tupaïa a longtemps été un mystère pour les géographes : illisible pour les occidentaux, on s’est parfois demandé si elle ne relevait pas de la fiction. Pourtant, elle représente un élément fondamental pour comprendre le « premier contact ». Tupaïa, prêtre-navigateur de Tahiti, originaire de Raiatea, a accompagné J. Cook lors de son premier voyage. Il a été le pilote du Dolphin dans la reconnaissance des îles polynésiennes. A la demande de Cook et de Banks, il a dessiné une carte. Nous chercherons à comprendre comment cette carte peut nous permettre aujourd’hui de repenser le « premier contact », en illustrant, par et avec la carte, l’incommensurabilité des appréhensions de l’espace.
|
Éric Puisais, docteur en philosophie et docteur en géographie, est maître de conférences en sciences politiques. Il est également directeur de programme au Collège International de Philosophie où sa recherche porte sur les liens entre la justice sociale et la justice spatiale. |
☞ Urs Urban
L’Atlas sentimental de la España vacía (2021) de Sergio del Molino : Topographies du vide dans l’imaginaire littéraire
L’Atlas sentimental de la España vacía (2021) est le troisième volet d’un projet livresque dans lequel le journaliste et écrivain Sergio del Molino se propose de cartographier la « psychogéographie de l’Espagne ». Ce qui l’intéresse avant tout, c’est ce qu’il appelle « l’Espagne vide », c’est-à-dire la grande majorité du pays au-delà des grandes métropoles (Madrid et Barcelone) et de la région côtière qui, sans jamais vraiment avoir été dépeuplée ou « décivilisée », a toujours été imaginée et mise en discours comme un espace vide dans lequel on a cru pouvoir situer toutes sortes de formes de vie « autres ». Ce sont ces espaces imaginés que l’on trouve dans son Atlas – tout comme dans des textes littéraires, en général fictifs, qui s’inscrivent, de leur côté, dans le discours sur « l’Espagne vide ».
Dans ma contribution, je me propose d’expliciter l’argumentation de del Molino et de rendre visible sa cartographie de l’Espagne vide en partant de son Atlas, avant d’identifier ses coordonnées dans la littérature narrative contemporaine et de montrer, à l’exemple du roman Intemperie de Jesús Carrasco (2013), comment celui-ci met en discours une « topographie du vide ».
|
Urs Urban est enseignant-chercheur en langues et littératures romanes. Après des stations à Strasbourg et Buenos Aires, il est actuellement maître de conférences HDR à la Maison des langues de l’Université Bauhaus à Weimar (Allemagne). Domaines de recherche principaux : Jean Genet, la théorie de l’espace, le storytelling et la conjoncture du récit épique, l’économie de la littérature, la représentation de la crise et la crise de la représentation (Argentine), le nouveau cinéma argentin. Il a récemment publié la monographie issue de son HDR soutenue en 2022 à l’Université Humboldt de Berlin : Conflit et médiation. L’économie du roman dans la Première Modernité (Espagne / France) (2024). |
ATTENTION FICTION ! MONDES IMAGINAIRES, POSSIBLES NARRATIFS ET FICTIONS PENSANTES DE L'ÂGE CLASSIQUE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES
Colloque à Cerisy du 19 au 25 juin 2025 organisé par Françoise Lavocat et Franck Salaün
Par Charlotte KRAUSS le 21 juin 2025

D'après Orson Welles, Don Quijote, 1955-1972,
inachevé, sortie posthume en 1992
ATTENTION FICTION !
MONDES IMAGINAIRES, POSSIBLES NARRATIFS ET FICTIONS PENSANTES
DE L'ÂGE CLASSIQUE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES
DU JEUDI 19 JUIN (19 H) AU MERCREDI 25 JUIN (14 H) 2025
DIRECTION :
Françoise LAVOCAT, Franck SALAÜN
COMITÉ D'ORGANISATION :
Nathalie KREMER, Anthony MANGEON, Pascal NOUVEL
pour plus d'infos: https://cerisy-colloques.fr/fiction2025/
ARGUMENT :
Longtemps considérée comme contraire au savoir et à l'utile, trompeuse, corruptrice, la fiction a largement pris sa revanche. On lui prête aujourd'hui d'innombrables vertus (pour l'éducation de l'enfant à la sociabilité, pour le développement de l'empathie chez l'individu, pour le soin et même pour la préservation de l'espèce), tant et si bien que la frontière entre le fictif et le réel peut parfois sembler disparaître. Elle dirait aussi bien ou mieux la réalité que le récit historique, elle permettrait au lecteur de développer son sens moral ou d'accéder à la complexité du réel en le plongeant dans des expériences de pensée ou des études de cas.
Ce colloque réunira des écrivains, des universitaires et des comédiens dans le but de dresser un état des lieux des théories et des usages de la fiction, en explorant notamment les oppositions traditionnelles ou plus récentes, les frontières et les intersections. On s'interrogera collectivement sur ce retour en grâce et les éventuels malentendus qu'il pourrait cacher, mais surtout sur la nature de la fiction, ses présupposés anthropologiques et ses multiples potentialités. Les conférences, tables rondes, ateliers et spectacles permettront en particulier d'explorer les mondes imaginaires, les possibles narratifs et les fictions pensantes.
MOTS-CLÉS :
Éducation, Fake news, Fiction, Fictionnalité, Imagination, Intelligence artificielle, Philosophie, Réalité, Récit, Référentialité, Roman, Story-telling, Théâtre, Théorie littéraire
CALENDRIER PROVISOIRE (19/06/2025) :
Jeudi 19 juin
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée
Présentation du Centre, des colloques et des participants
Vendredi 20 juin
USAGES ET FRONTIÈRES DE LA FICTION DU XVIe SIÈCLE À AUJOURD'HUI
Matin
Françoise LAVOCAT, Pascal NOUVEL & Franck SALAÜN : Introduction
Présentation de la Société internationale des recherches sur la fiction et la fictionnalité (SIRFF)
Après-midi
Charlotte KRAUSS : Les Cités obscures de Schuiten et Peeters comme fictions pensantes
Les dangers de la fiction, atelier avec l'aide de Luca PENGE
Soirée
Linda GIL : Cunégonde ou Voltaire contre ses interprètes [conférence interactive]
Samedi 21 juin
Matin
TÉMOIGNAGE ET FICTION
Dominique MEMMI : Vers une vengeance des femmes ? Fictions et sciences sociales
Aude DÉRUELLE : Le désir de roman des historiens
Après-midi
L'UNIVERS DU ROMAN SANS FICTION. AUTOUR DU TRAVAIL DE PATRICK DEVILLE
Table ronde et lectures, avec Patrick DEVILLE, Linda GIL, Françoise LAVOCAT et Franck SALAÜN
Soirée
En commun avec le colloque en parallèle : L'équipe de film à l'épreuve du territoire
Dimanche 22 juin
Matin
PENSER DANS ET PAR LA FICTION
Ridha BOULAÂBI : Mise en fiction des enjeux postcoloniaux
Anthony MANGEON : Fictions primates : quand les singes parlent [visioconférence]
Après-midi
ESPACES FICTIONNELS
Franck SALÄUN : Figurer la grande pantomime du Neveu de Rameau, avec Michel TOMAN
À propos de La Blessure et la Soif, avec Pascal NOUVEL, Laurence PLAZENET et Catherine SCHAUB
Soirée
La Blessure et la Soif, lecture par Cassandre VITTU DE KERRAOUL
Lundi 23 juin
Matin
ARBITRAIRE DU TEXTE ET VÉRITÉ DE LA FICTION
Franc SCHUEREWEGEN : Attention fiction d'auteur (sur Racine, entre autres)
Sjef HOUPPERMANS : Impressions d'Afrique de Raymond Roussel
Répondante : Camille BORTIER
Après-midi
DÉTENTE
Soirée
En commun avec le colloque en parallèle : L'équipe de film à l'épreuve du territoire
Mardi 24 juin
Matin
LES ENJEUX DU RÉCIT
Colas DUFLO : Le "roman politique" au XVIIIe siècle ou la philosophie politique par fiction
Pascal NOUVEL : Histoire, politique et puissance du narratif
Après-midi
Présentation de mise en voix de contes, écrits par les élèves de 6ème du collège Anne Heurgon-Desjardins de Cerisy-la-Salle
FAÇONS DE REPRÉSENTER
Ivan JABLONKA : Représenter le féminicide avec des fictions
Nathalie KREMER & le ZufallKollektiv : Mettre en scène le Pygmalion de Rousseau
Soirée
Pygmalion de Rousseau, spectacle par le ZufallKollektiv (Suisse) : Dominique BOURQUIN, Joséphine DE WECK, Simon LAMBELET, Nicolas MÜLLER et Michel TOMAN
Mercredi 25 juin
Matin
MYSTIFICATIONS, SAVOIRS, DROITS : L'AVENIR DE LA FICTION
Table ronde, puis Rapports d'étonnement des doctorants (coordonnés par Luca PENGE)
Après-midi
DÉPARTS
SOUTIENS :
• Institut universitaire de France (IUF)
• Institut de recherche sur la Renaissance, l'Âge classique et les Lumières (IRCL, UMR 5186)
Michèle Bokobza KAHAN
Par Charlotte KRAUSS le 11 juillet 2025

micheleb@tauex.tau.ac.il
Discipline : Littérature
Champ de recherche : Les Lumières en France, littérature contemporaine, roman et témoignage, discours dissident, discours féminin
Website : https://orcid.org/0000-0002-9964-3019
CV : Libertinage et Folie dans le roman du 18e siècle (Peeters, 2000), Dulaurens et son œuvre : Un auteur marginal au XVIIIe siècle : Deviances discursives et Bigarrures philosophiques (Champion, 2010), Témoigner des miracles au siècle des Lumières : Récits et discours de Saint-Médard (Garnier Classique, 2015). She has edited and presented Mémoires d'une honnête femme de Chevrier (collection Lire le Dix-huitième siècle, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2005). She has directed a special issue on
Mots-clés : Autobiographie, Émotions, Fait et Fiction, Factualité, Narratologie, Personnages, Réalisme, Romans
Miadana Annecy ANDOANJARASOA
Par Charlotte KRAUSS le 11 juillet 2025

soatody@gmail.com
Discipline : Littérature francophone
Champ de recherche : Littérature francophone (Bande dessinée contemporaine, intermédialité)
Mots-clés : Bandes dessinées, romans graphiques, manga, Image, Personnages, Sociologie